Planneur Romantique #72
La possibilité d'un PPT : Zweig, Stefan. Le monde d'hier: souvenirs d'un européen (Cycle de l'apocalypse 2/X)
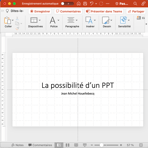
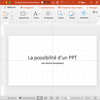
La possibilité d'un PPT
12 min ⋅ 10/03/2025
Père ManQ, raconte-nous une histoire.
Ils passaient leurs heures à l’Agence Havas, comme Paul Valéry,
ManQr passait ses heures à l’Agence Havas - sauf celles en distancielles, mais toujours deux vendredis par mois comme l’oblige la politique de l’entreprise, presque que - comme Paul Valéry.
Quelle épitaphe !
Evacuons tout de suite le truisme de la pièce (j’ai longtemps hésité entre plusieurs expressions puis je me suis arrêté sur du Bleuge).
Le monde d’hier (et pas d’avant, comme le plouc que je suis l’a indiqué la semaine dernière) est la lettre de suicide - un poil longue - personnelle de l’auteur et celle, collective, d’un continent entier.
Zweig décrit moins un passé lointain que notre futur immédiat européen - phrase piquée à Michel Hazanavicius - et le lire en ce début mars 2025 est perturbant.
C’est une loi inéluctable de l’histoire qu’elle défend aux contemporains des grands mouvements qui déterminent leur époque de les reconnaître dans leurs premiers commencements.
L’inflation, le chômage, les crises politiques et pour une bonne part la folie des gouvernements étrangers avaient soulevé le peuple allemand ; un incoercible désir d’ordre se manifesta dans toutes les classes de ce peuple, pour qui l’ordre a toujours eu plus de prix que la liberté et le droit. Et quiconque promettait l’ordre, – même Goethe a dit que le désordre lui paraîtrait plus fâcheux qu’une injustice, – avait dès le principe des centaines de milliers de gens derrière lui.
Car le nazisme avec sa technique de l’imposture dénuée de scrupules se gardait bien de montrer tout le caractère radical de ses visées, avant qu’on eût endurci le monde. Ils appliquaient leurs méthodes avec prudence : on procédait par doses successives et après chaque dose, on ménageait une petite pause. On administrait toujours une pilule à la fois et ensuite venait un moment d’attente, pour voir si elle n’avait pas été trop forte, si la conscience du monde pouvait encore supporter cette dose.
On voyait s’assombrir les visages de ceux qui achetaient les journaux, mais cela ne durait toujours que quelques minutes. Après tout, nous connaissions depuis des années les conflits diplomatiques ; ils étaient toujours apaisés heureusement à la dernière heure, avant que cela devînt sérieux. Pourquoi pas cette fois encore ?
Je lis ça, pile au moment où Emmanuel Macron se lance dans une reprise de Nino Ferrer sur TF1 “Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre”
Une décision, on le sentait, était dans l’air, et, dans le sentiment de la tension générale, je songeais, plein d’appréhension, aux paroles de Shakespeare : « So foul a sky clears not without a storm. » (Un ciel aussi sombre ne s’éclaircit pas sans une tempête.)
Un livre avec du Shakespeare dedans est toujours mieux qu’un livre sans Shakespeare.
Faisons face au temps comme il nous cherche.
“Jeter un dernier regard à la paix” pas mal, non ?
Je redescendis à la ville, afin de jeter un dernier regard à la paix.
Le monde d’hier c’est un monde solide, figé et dans lequel personne ne courait jamais. Jamais quelqu’un n’aurait gravi des escaliers en courant.
Les machines, l’auto, le téléphone, la radio, l’avion n’avaient pas encore imposé aux hommes le rythme des nouvelles vitesses, le temps et l’âge avaient une autre mesure.
Un ami m’a un jour dit que la grande force de J.Séguéla c’était la rapidité de ses prises de décisions.
L’expérience m’a appris que c’était vrai, décider vite est un avantage concurrentiel.
Toujours, quand les événements se précipitent, les natures qui savent se jeter à l’eau sans hésiter ont l’avantage sur les autres.
La notion de tourisme inflationniste.
les buveurs de bière bavarois calculaient tous les jours en consultant l’indice des cours si, dans la région de Salzburg, ils pourraient, avec la dépréciation de la couronne, boire cinq ou six, ou dix litres pour le prix qu’ils payaient chez eux un litre. On ne pouvait pas imaginer de tentation plus alléchante, et ainsi des bandes d’habitants des localités voisines de Freilassing et de Reichenhall passaient la frontière avec femmes et enfants pour s’accorder le luxe d’ingurgiter autant de bière que leur verre en pouvait contenir.
Zweig considérait que les grandes oeuvres (Balzac et Thomas Mann entre autres) étaient toujours beaucoup trop longues. Aussi, j’ai demandé à GPT de synthétiser mes notes en quelques bullet points :
Le progrès accélère le temps : chaque innovation technique (auto, téléphone, radio…) impose un nouveau rythme à la vie.
Quand tout vacille, l’absurde rassure : les formes traditionnelles (art, langage, amour) sont renversées par goût de la rupture.
Consommer pour survivre : face à l’incertitude, acheter devient un réflexe primal, une quête de "substance".
L’ordre, un désir refoulé : après le chaos, l’envie de cadre dépasse celle de liberté.
Les jeunes brûlent les modèles : cheveux coupés, genres brouillés, mœurs réinventées – chaque révolte est une réinvention de soi.
Retour des croyances magiques : quand la réalité inquiète, l’irrationnel séduit (spiritisme, théories extrêmes).
La culture, ciment social : l’art prospère là où il est au cœur de la vie collective.
La vraie valeur apparaît dans la perte : ce qu’on croyait acquis (sécurité, stabilité) ne prend son prix qu’au moment de sa disparition.
On ne sort jamais indemne de son époque : l’air du temps s’incruste dans le sang – on ne revient pas en arrière.
Citations et idées remarquables.
Faisons face au temps comme il nous cherche.
— SHAKESPEARE : Cymbeline.
Contre ma volonté j’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu’atteste la chronique des temps ; jamais, – je ne le note point avec orgueil, mais avec un sentiment de honte, – une génération n’est tombée comme la nôtre d’une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale.
Jamais jusqu’à notre époque l’humanité dans son ensemble ne s’est révélée plus diabolique et n’a accompli tant de miracles qui l’égalent à la divinité.
Pour notre génération il n’y a point d’évasion, point de retraite hors du réel présent ; grâce à notre nouvelle organisation du synchronisme universel, nous sommes constamment engagés dans notre époque.
Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture qu’un mince sédiment qui à chaque instant peut être crevé par les puissances destructrices du monde souterrain, nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terrain solide sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité.
Ce qu’un homme a, durant son enfance, incorporé à son sang de l’air du temps ne saurait plus être éliminé.
Toujours l’artiste se sent le plus à l’aise et aussi le plus excité à produire là où il est estimé et même surestimé, toujours l’art atteint à son apogée là où il est mêlé à la vie de tout un peuple.
On ne méprisait pas la tolérance comme un signe de mollesse et de débilité, on la prisait très haut comme une force morale.
Les machines, l’auto, le téléphone, la radio, l’avion n’avaient pas encore imposé aux hommes le rythme des nouvelles vitesses, le temps et l’âge avaient une autre mesure.
On peut rattraper plus tard ce qu’on a négligé du côté des muscles ; l’élan vers le spirituel, la puissance d’appréhension de l’âme ne s’exerce que dans les années décisives de la formation, et seul celui qui a appris de bonne heure à épanouir largement son âme a plus tard le pouvoir de contenir en lui le monde entier.
Mais comme Frédéric Hebbel le disait un jour fort joliment : « Tantôt nous manque le vin, tantôt la coupe. » Rarement l’un et l’autre sont accordés à la même génération ; si les mœurs laissent à l’homme quelque liberté, c’est l’État qui le contraint. Si l’État ne l’opprime pas, ce sont les mœurs qui tentent de l’asservir.
Pour moi, l’axiome d’Emerson est demeuré inébranlable, que les bons livres remplacent la meilleure université,
Et être seul à aimer quelqu’un, c’est toujours l’aimer doublement.
Tout, à Paris, était déjà familier à mon esprit grâce à l’art évocateur des poètes, des romanciers, des historiens, des peintres de mœurs, avant que je le visse de mes yeux. Tout ne faisait que se ranimer au cours de mes rencontres, la vision concrète n’était en réalité que reconnaissance, cette joie de l’anagnôsis des Grecs qu’Aristote loue comme la plus grande et la plus mystérieuse des jouissances artistiques.
Ils passaient leurs heures à l’Agence Havas, comme Paul Valéry,
le meilleur des Français était en même temps l’adversaire le plus passionné du nationalisme.
Durant cette heure j’avais vu à découvert le secret éternel de tout grand art et, en somme, de toute humaine production : la concentration, le rassemblement de toutes les forces, de tous les sens, la faculté de s’abstraire de soi-même, de s’abstraire du monde, qui est le propre de tous les artistes. J’avais appris quelque chose pour la vie.
On voyait s’assombrir les visages de ceux qui achetaient les journaux, mais cela ne durait toujours que quelques minutes. Après tout, nous connaissions depuis des années les conflits diplomatiques ; ils étaient toujours apaisés heureusement à la dernière heure, avant que cela devînt sérieux. Pourquoi pas cette fois encore ?
Et malgré ma haine et mon horreur de la guerre, je ne voudrais pas être privé dans ma vie du souvenir de ces premiers jours. Les milliers et les centaines de milliers d’hommes sentaient comme jamais, ce qu’ils auraient dû mieux sentir en temps de paix, à savoir à quel point ils étaient solidaires.
Mon corps, mes nerfs, après de longs mois de succédanés, ne supportaient plus le vrai café, le vrai tabac ; le corps lui-même, habitué à l’antinaturel de la guerre, avait besoin de s’adapter au naturel de la paix.
La figure la plus extraordinaire de ce groupe était Henri Guilbeaux ; en sa personne j’ai trouvé confirmée d’une manière plus convaincante que dans aucune autre cette loi immuable de l’histoire que dans des époques de violents bouleversements, surtout au cours d’une guerre, ou d’une révolution, l’audace et la témérité ont souvent plus d’efficace dans le présent immédiat que la valeur intrinsèque, et qu’un bouillant courage civique peut être plus décisif que le caractère et la constance. Toujours, quand les événements se précipitent, les natures qui savent se jeter à l’eau sans hésiter ont l’avantage sur les autres.
S’étourdir ! me dit-il en montrant du doigt les bouteilles. Non pas boire, mais il faut parfois s’étourdir, sinon on ne le supporterait pas. La musique ne le peut pas toujours, et le travail ne nous visite qu’aux bonnes heures. »
pour la première fois j’appris à observer bien le type éternel du révolutionnaire professionnel, qui, par son attitude de pure opposition, se sent grandi dans son insignifiance et se cramponne aux dogmes, parce qu’il ne trouve aucun point d’appui en lui-même.
Car nous croyions – et le monde entier le croyait avec nous, – que par cette guerre le sort de « la guerre » était réglé pour tous les temps, que la bête était domptée ou même tuée, qui avait ravagé notre monde.
Pour la première fois dans l’histoire, du moins à ma connaissance, se produisit ce fait paradoxal qu’on contraignit un pays à une indépendance qu’il déclinait lui-même avec acharnement.
Ainsi l’on décréta : La république de l’Autriche-allemande doit subsister. Fait unique dans l’histoire, à un pays qui ne voulait pas exister, on commandait : « Tu dois exister ! »
Un économiste qui saurait décrire d’une manière vivante toutes ces phases de l’inflation en Autriche d’abord, puis en Allemagne serait, à mon avis, plus captivant que n’importe quel romancier, car le chaos revêtit des formes de plus en plus fantastiques. Bientôt plus personne ne sut ce que coûtait un objet. Les prix faisaient des bonds tout à fait arbitraires ; une boîte d’allumettes coûtait, dans un magasin qui en avait fait monter le prix au bon moment, vingt fois plus que dans un autre, où un brave homme vendait encore naïvement sa marchandise au prix de la veille ; en récompense de son honnêteté, son magasin se vidait en une heure, car on se le disait, chacun courait et achetait ce qui était à vendre, qu’il en eût besoin ou non. Même un poisson d’or ou un vieux télescope était encore de la « substance », et tout le monde voulait de la substance au lieu de papier. Cette situation fausse produisit ses effets les plus grotesques dans la question des loyers : le gouvernement, pour protéger les locataires (qui représentaient la grande masse), au détriment des propriétaires, avait interdit toute augmentation. Il se trouva bientôt qu’en Autriche le loyer annuel d’un appartement moyen coûta moins au locataire qu’un seul repas ; toute l’Autriche a en quelque sorte été logée gratuitement pendant cinq ou dix années (car plus tard aussi toute résiliation fut interdite).
On « découvrait » l’Autriche, qui connut une néfaste « saison d’étrangers ». Tous les hôtels de Vienne étaient pleins de ces vautours ; ils achetaient tout, depuis la brosse à dents jusqu’au domaine rural, ils vidaient les collections des particuliers et les magasins d’antiquités, avant que les propriétaires, dans leur détresse, soupçonnassent à quel point ils étaient dépouillés et volés. De petits portiers d’hôtel venus de Suisse, des sténo-dactylographes de Hollande habitaient les appartements princiers des hôtels du Ring. Si incroyable que paraisse le fait, je puis le certifier, parce que j’en ai été le témoin, le célèbre et luxueux Hôtel de l’Europe de Salzburg a été loué pour un temps prolongé à des chômeurs anglais qui, grâce aux subsides que l’Angleterre accordait généreusement aux sans travail, vivaient ici à meilleur compte que chez eux dans leurs bouges.
Un article, cependant, demeurait libre et ne pouvait être saisi, la bière qu’on avait absorbée. Et les buveurs de bière bavarois calculaient tous les jours en consultant l’indice des cours si, dans la région de Salzburg, ils pourraient, avec la dépréciation de la couronne, boire cinq ou six, ou dix litres pour le prix qu’ils payaient chez eux un litre. On ne pouvait pas imaginer de tentation plus alléchante, et ainsi des bandes d’habitants des localités voisines de Freilassing et de Reichenhall passaient la frontière avec femmes et enfants pour s’accorder le luxe d’ingurgiter autant de bière que leur verre en pouvait contenir.
En plein chaos financier, la vie quotidienne se poursuivait presque sans trouble. Les situations individuelles se modifiaient profondément, des riches s’appauvrissaient, parce que l’argent placé dans les banques ou en obligations de l’État se fondait. Mais le volant continuait de tourner sur le même rythme, sans se soucier du sort des particuliers, rien ne s’arrêtait ; le boulanger faisait cuire son pain, le cordonnier confectionnait ses chaussures, l’écrivain composait ses livres, le paysan cultivait la terre, les trains circulaient régulièrement, chaque matin le journal était déposé devant la porte à l’heure habituelle, et les lieux de divertissement, les bars, les théâtres étaient bondés. Mais justement par le fait de cette circonstance imprévue, que la valeur qui avait été la plus stable, que l’argent se dépréciait tous les jours, les hommes en venaient à estimer d’autant plus les vraies valeurs de la vie, le travail, l’amour, l’amitié, l’art et la nature, et tout le peuple vivait en pleine catastrophe avec plus d’intensité que jamais
Mais ce n’est qu’extérieurement et dans le sens politique, que le bouleversement radical fut évité ; intérieurement s’accomplissait une formidable révolution durant ces années d’après-guerre. Quelque chose avait succombé avec les armées : la foi en l’infaillibilité des autorités, dans laquelle notre jeunesse avait été élevée avec un excès d’humilité.
N’était-il pas compréhensible que toute forme du respect disparût dans la nouvelle génération ? Toute une neuve jeunesse ne croyait plus aux parents, aux politiques, aux maîtres ; chaque ordonnance, chaque proclamation de l’État était lue d’un œil méfiant.
Dans les écoles, on constituait, sur le modèle russe, des comités de classe qui surveillaient les professeurs, le « plan d’études » était aboli, car les enfants ne devaient et ne voulaient apprendre que ce qu’il leur plaisait. On se révoltait contre toutes les formes valables par le seul goût de la révolte, même contre le vœu de la nature, contre l’éternelle polarité des sexes. Les filles se faisaient couper les cheveux, et de si près qu’avec leurs têtes de garçonnets, on ne pouvait les distinguer des vrais garçons ; les jeunes hommes, de leur côté, se rasaient la barbe, pour paraître plus féminins, l’homosexualité et les mœurs lesbiennes furent la grande mode, non pas par un penchant inné, mais par esprit de protestation contre les formes traditionnelles, les formes légales et normales de l’amour.
Partout on proscrivait l’élément intelligible, la mélodie en musique, la ressemblance dans un portrait, la clarté de la langue. Les articles « le, la, les » furent supprimés, la construction de la phrase mise cul par-dessus tête, on écrivait « escarpé » et « abrupt », en style télégraphique, avec de fougueuses interjections ; au demeurant toute littérature qui n’était pas « d’action », c’est-à-dire qui ne consistait pas en théories politiques, était vouée à la poubelle.
C’était l’âge d’or de tout ce qui était extravagant et incontrôlable : la théosophie, l’occultisme, le spiritisme, le somnambulisme, l’anthroposophie, la chiromancie, la graphologie, le yogisme hindou et le mysticisme paracelsien. Tout ce qui promettait des transes qu’on n’avait pas encore éprouvées, toute espèce de stupéfiants, la morphine, la cocaïne et l’héroïne, étaient d’un débit rapide, au théâtre l’inceste et le parricide, dans la politique le communisme et le fascisme étaient les seuls thèmes extrêmes qu’on accueillît favorablement ; en revanche on proscrivait sans appel tout ce qui était normal et mesuré.
J’ai vécu des journées où je payais le matin cinquante mille marks pour un journal et le soir cent mille ;
un lacet de soulier coûtait plus cher que précédemment un soulier, et ce n’est rien dire, plus cher en vérité qu’un magasin luxueux avec deux mille paires de chaussures, une vitre à remplacer plus que précédemment toute la maison, un livre plus que l’imprimerie avec ses centaines de machines. Pour cent dollars on pouvait acheter par files des maisons
Rien ne fut plus fatal à la république allemande que sa tentative idéaliste de laisser la liberté au peuple et même à ses ennemis. Car le peuple allemand, un peuple ami de l’ordre, ne savait que faire de sa liberté et tournait ses regards impatients vers ceux qui devaient la lui ravir.
si déjà la vie est en soi pleine de séductions et de surprises, à plus forte raison la double vie
Ces mêmes villes de Galicie que j’avais vues en ruines en 1915 se dressaient maintenant toutes neuves et propres ; je reconnaissais une fois de plus que dix années, qui dans la vie d’un individu comptent pour une part importante de son existence, ne sont qu’un clin d’œil dans la vie d’un peuple.
« C’est justement la résistance qui nous rajeunit. Si j’étais resté sénateur, ma vie aurait été trop facile, il y a longtemps que mon esprit serait devenu paresseux et inconséquent. Rien n’est plus nuisible aux hommes qui pensent que le défaut de résistance ; ce n’est que depuis que je suis seul et que je ne sens plus la jeunesse autour de moi, que je suis forcé de rajeunir moi-même. »
J’ai mis ma joie dans mon travail de création, jamais dans ce que j’avais créé.
C’est une loi inéluctable de l’histoire qu’elle défend aux contemporains des grands mouvements qui déterminent leur époque de les reconnaître dans leurs premiers commencements.
L’inflation, le chômage, les crises politiques et pour une bonne part la folie des gouvernements étrangers avaient soulevé le peuple allemand ; un incoercible désir d’ordre se manifesta dans toutes les classes de ce peuple, pour qui l’ordre a toujours eu plus de prix que la liberté et le droit. Et quiconque promettait l’ordre, – même Goethe a dit que le désordre lui paraîtrait plus fâcheux qu’une injustice, – avait dès le principe des centaines de milliers de gens derrière lui.
Car le nazisme avec sa technique de l’imposture dénuée de scrupules se gardait bien de montrer tout le caractère radical de ses visées, avant qu’on eût endurci le monde. Ils appliquaient leurs méthodes avec prudence : on procédait par doses successives et après chaque dose, on ménageait une petite pause. On administrait toujours une pilule à la fois et ensuite venait un moment d’attente, pour voir si elle n’avait pas été trop forte, si la conscience du monde pouvait encore supporter cette dose.
Il est difficile de se dépouiller en quelques semaines de trente ou quarante ans de foi au monde.
Mais tous ceux avec qui je parlai à Vienne montraient une sincère insouciance. Ils s’invitaient mutuellement en smoking et en frac à des soirées (sans se douter qu’ils allaient porter les costumes de détenus dans les camps de concentration), ils prenaient d’assaut les magasins pour y faire les achats de Noël dont ils remplissaient leurs belles maisons (sans se douter que peu de mois après on les leur prendrait et les pillerait).
Même les Juifs ne se donnaient pas de tracas et se comportaient comme si la disqualification des médecins, des avocats, des savants, des acteurs se passait en Chine et non à trois heures de chemin de fer, dans le même domaine linguistique. Ils étaient tranquillement installés dans leurs maisons et roulaient en automobile. De plus, chacun avait cette petite sentence consolante à la bouche : « Cela ne peut pas durer longtemps. » Mais moi, je me souvenais d’une conversation que j’avais eue au cours de mon voyage en Russie avec mon ancien éditeur de Léningrad. Il m’avait raconté quel homme riche il avait été, quels beaux tableaux il avait possédés et je lui avais demandé pourquoi il n’était pas parti comme tant d’autres dès le début de la révolution. « Hélas ! m’avait-il répondu, qui aurait pu croire alors qu’une chose telle que la République des ouvriers et soldats pourrait durer plus de quinze jours ? » C’était la même illusion, qui procédait de la même volonté de s’illusionner soi-même.
De loin, je souffrais tous les jours de sa lente et fiévreuse agonie, – infiniment plus que mes amis qui étaient restés au pays, qui se trompaient eux-mêmes par des démonstrations patriotiques et se répétaient tous les jours cette assurance : « La France et l’Angleterre ne peuvent pas nous laisser tomber. Et avant tout Mussolini ne le permettra pas. » Ils croyaient à la Société des Nations, aux traités de paix, comme les malades croient aux médecines munies de belles étiquettes. Ils vivaient heureux et insouciants, tandis que moi, qui voyais les choses plus clairement, je me dévorais le cœur de soucis.
Des générations antérieures pouvaient encore en temps de catastrophes se réfugier dans la solitude et la retraite ; il nous était réservé à nous de savoir et d’éprouver à l’heure, à la seconde même, tout ce qui se passe de pire à la surface de notre planète.
Nous pensons tous avec fort peu d’orgueil à l’aveuglement politique de ces années-là, et reconnaissons avec un frisson d’horreur où il nous a menés ; quiconque voudrait expliquer devrait accuser, et qui d’entre nous en aurait le droit ?
Et rien ne me paraît plus caractéristique de la singularité et de la technique des révolutions modernes que le fait que, se déroulant dans l’espace immense d’une grande ville, elles n’intéressent en réalité que très peu d’endroits et demeurent ainsi parfaitement invisibles pour la plupart des habitants.
j’ai toujours trouvé confirmé ce phénomène extraordinaire, que, dans notre temps, à dix rues de distance, on en sait moins sur les événements décisifs qu’à des milliers de kilomètres.
Une décision, on le sentait, était dans l’air, et, dans le sentiment de la tension générale, je songeais, plein d’appréhension, aux paroles de Shakespeare : « So foul a sky clears not without a storm. » (Un ciel aussi sombre ne s’éclaircit pas sans une tempête.)
Je redescendis à la ville, afin de jeter un dernier regard à la paix. Elle reposait tranquillement dans la lumière de midi et ne semblait pas différente de ce qu’elle avait toujours été.
Mais toute ombre, après tout, est fille de la lumière et seul celui qui a éprouvé la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu.









